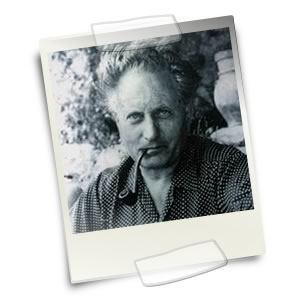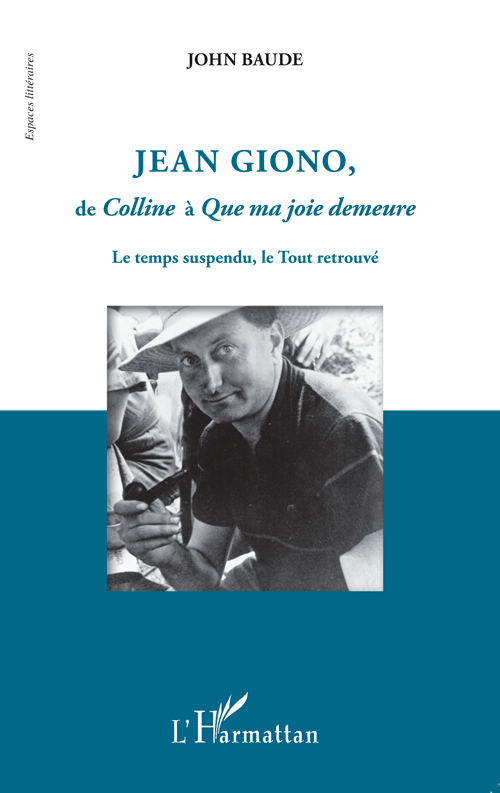- Publication : 28 novembre 2011
Le plateau, un avant-pays de Jean Giono
dans Que ma joie demeure
John Baude
Deux romans écrits par Giono au début des années trente, Regain et Que ma joie demeure, ont pour lieu un plateau et, dans un texte de 1930, intitulé précisément Manosque-des-Plateaux, de longs développements lui sont consacrés. Il peut inspirer à l'auteur des sentiments contradictoires mais il le fascine.
Il [le plateau de Valensole] est le mauvais compagnon. Entendons-nous : il est pour moi l’ami magnifique, mais il est le mauvais compagnon de ce paysan des plaines. (…) Ce qui inquiète c’est son silence. Il est là-bas, il ne dit rien. (…). Et lui, il est là-bas toujours pareil, toujours muet ; il rêve, pensez-vous à regarder à plein visage la belle lune de jour qui vole avec ses deux cornes au-dessus de lui. (…).
Il est quand même, pour moi, l’ami magnifique. Qui n’a pas son caractère ? Mais, par les beaux dimanches d’août, quand on lui a rasé sa chevelure de blé, quand il est crâne nu sous le poids de feu qui fait craquer l’argile du ciel, alors il sait, d’un enseignement sûr, vous mener jusqu’au fond sensible de la vie (…). (Manosque-des-Plateaux p.20-21) [1]
Et puis, justement, ce plateau est un doux sorcier et un magnifique poète. (Manosque des Plateaux p.38)
Or, ce rapport au lieu se révèle déterminant dans le roman Que ma joie demeure. Car, comme l’écrit Robert Ricatte, « toute cette présence variable de l’espace dans le génie de Giono aurait une conséquence bien dérisoire pour la critique si elle devait déboucher sur de l’admiration pour des dons descriptifs, si admirables soient-ils. Il s’agit de bien autre chose. On se doute d’abord que le substrat psychologique des personnages et les statuts réciproques de l’analyse et du récit deviennent extrêmement particuliers si les êtres imaginaires que produit le roman sont définis et mis en acte surtout en fonction de l’espace qui les englobe.»[2]
Ainsi Bobi, héros du roman, qui vient on ne sait d’où, qui est l’homme des chemins et de la route, sera celui qui remettra en mouvement le monde grippé du plateau Grémone. Sa venue, alors qu’il est inconnu de tous, contribue à ce que les paysans unissent leurs forces pour moissonner ou bien à ce qu’ils partagent un repas et leur découverte de nouvelles raisons de vivre. D’un lieu à l’écart, le plateau devient un monde. La conscience collective des paysans se développe à mesure que se crée l’unité de ce lieu dans leur imagination. « La topographie rigoureuse d’un lieu n’est plus (…) qu’un matériau pour construire l’espace romanesque. Celui-ci n’est pas à la mesure de l’homme, mais devient un élément essentiel d’une poétique où l’image est souvent plus importante que la réalité. »[3]
Ce lieu, le plateau, en réponse au vertige qui s’est emparé des paysans, à l’angoisse née d’un vide horizontal sans limites, comme largement répandu à la surface de la terre, sera déréalisé. Il deviendra un enclos rond libéré d’une sensation d’écrasement, un volume à emplir jusqu’à le saturer de leur visions, jusqu’à ce que l’imagination, faute de vide à combler, s’épuise, s’immobilise dans une contemplation panoramique où la transformation du réel finira supplantée par le retour du temps.
1. Rêver un enclos
Le plateau : un monde et un malaise
Il y a bien des vallées, des plaines, des forêts et des montagnes décrits tout au long du roman Que ma joie demeure, voire une ville dont l’évocation se limite à un nom, mais ils sont vus le plus souvent à partir du plateau Grémone, foyer du regard sur le monde environnant. Ce point de vue et la concentration de l’intrigue sur cette vaste scène - autre acception du mot plateau - confèrent à ce lieu, ainsi distinct des autres, une unité que n’entame pas la très relative diversité des paysages composés de champs, d’étendues d’herbes, de quelques marais et de brumes, et de rares maisons.
Le plateau Grémone apparaît silencieux et inhospitalier : désert, il ne compte aucun village, juste quelques fermes isolées, autant de relais pour le traverser, qui abritent une vingtaine d’habitants dispersés ; rude, les conditions de vie y sont difficiles. Giono accuse l’isolement et l’étendue des plateaux de Provence, qui l'inspirent :
Plateau de Valensole, que j’ai mis dans une situation beaucoup plus solitaire qu’il n’est, plateau de Saint-Jurs, qui est beaucoup plus éloigné […] et un plateau beaucoup plus petit qui s’appelle Saint-Geniez-de-Dromon, au-dessus de Sisteron.[4]
Si bien que ce lieu imaginaire, le plateau Grémone, tend à exclure ses habitants du monde extérieur, à ne leur proposer que la solitude, à laisser un mal intérieur et profond les envahir
Jourdan chercha le regard de ces hommes qui paraissaient en meilleur équilibre. Et alors il s’aperçut que, dès qu’ils s’arrêtaient de rire, ils avaient le même souci au fond de l’œil. Plus que souci, de la peur. Plus que de la peur, du rien. (II, 419)
De là dans les hommes des grands déserts d’hommes (…). (II, 609)
Un besoin de verticalité
De ce malaise, naît la tentation de recréer l’espace. Elle se nourrit d’un besoin de verticalité alors que domine un sentiment d’écrasement, le plateau étant proche du ciel, et sous sa chape.
Le clairon sonna encore. La dernière note était une note mélancolique et elle donnait l’idée du large plateau étendu sans force sous le ciel (II, 506)
Et elle montra vaguement l’étendue solitaire qui s’aplatissait sous le ciel gris (II, 666)
De son côté, comme devant lui, comme à droite et à gauche, c’était le ciel touchant la terre de tout son poids. (II, 765)
Giono ne confiait-il pas : «A midi l’été, dans les grandes solitudes toutes nues, sur le plateau d’Albion, on a peur véritablement, on est écrasé par une espèce de force plus grande que soi. »[5] ? Etendue plane, étau du ciel et de la terre, le plateau donne à l’homme l’impression de compresser tout volume car son regard ne rencontre pas d’alter ego vertical, en l’occurrence un arbre. « Seul, l’arbre tient fermement, pour l’imagination dynamique, la constance verticale» et «il semble que l’arbre isolé soit le seul destin vertical de la plaine et du plateau», écrit Bachelard qui, citant Claudel, ajoute que «l’arbre seul, dans la nature, pour une raison typifique, est vertical, avec l’homme.» [6]
L’homme du plateau, par son corps, par sa position debout, est l’unique élément vertical.
Sur le plateau, on n’y va pas souvent et jamais volontiers. C’est une étendue toute plate à perte de vue. C’est de l’herbe, et de l’herbe, et de l’herbe, sans un arbre. C’est plat. Quand on est debout là-dessus et qu’on marche, on est seul à dépasser les herbes. (Regain, I, 347)
Il se montre conscient de sortir seul « à découvert », de s’exposer.
Ça fait une drôle d’impression. Il semble qu’on est toujours désigné pour quelque chose. (Regain, I, 347)
Sur ce plateau si plat, si large, si bien tendu au soleil et le vent on n’est à son aise qu’assis. (…). Quand on marche c’est le contraire : on a l’air d’être nu, tout faible ; sur cette grande étendue plate il semble que partout des yeux vous regardent, des choses vous guettent. (Regain, I, 354)
Toutefois, il ne peut être lui-même l’élément vertical que cherche son regard car il ne s’inscrit pas dans son propre champ de vision : un regard ne peut voir son foyer. Dans ces conditions, rien ne se dresse qui puisse suggérer quelque verticalité si bien que l’homme sur le plateau nu peine à prendre sa place dans l’espace, à s’y projeter, à s’y représenter. Cette difficulté à être-là, à se penser-là, en l’absence de tout appui extérieur, creuse un malaise qui est « ruine de l’être, (…) ruine du Dasein » et qui, de surcroît, isole le paysan du plateau dans un vertige, « cette soudaine et totale solitude » [7]. Ce malaise présent dans Regain
Mais, à cet endroit-là, le plateau commence à être quelque chose de pas ordinaire. A perte de vue, immense et nu, et tellement, tellement plat à donner le mal au cœur, qu’il vous prend soudain le besoin de voir une chose qui monte en l’air. (Regain, I, 356)
l'est également dans Que ma joie demeure. Sur le plateau, souvent comparé à la mer dans les deux romans au point d'évoquer fréquemment le «large» («On était cette fois dans le grand large du plateau comme au milieu d’une mer», Regain, I, 362) et même le «plein large» comme on parle de la pleine mer («Le plein large ; il n’y a plus rien. » Regain, I, 353), l'homme éprouve la détresse du naufragé :
Ils regardèrent le large du plateau. Ils étaient seuls sur tout ce large sans rien apercevoir tout autour comme des perdus en mer. (II, 626)
De même, des similitudes entre la forêt, la mer et le désert, que mentionne Pierre Jourde dans son ouvrage Géographies imaginaires, pourraient s’étendre au plateau : « Le regard porté sur l’étendue boisée rejoint de quelque façon la contemplation de l’espace marin ou désertique : ce moutonnement sans fin empêche l’œil de s’arrêter sur un point déterminé, il lui ôte tout repère et toute base, le plonge dans le vertige de ce qui n’a ni forme ni limite précise. (…). Et le regard attend, exige la venue d’un signe ».[8]
Pour conjurer ce mal, naît en lui un besoin de verticalité[9], « comme si la volonté de redressement volait au secours de la matière écrasée ».[10]
Moyens de la verticalité
La verticalité qui fait défaut sur un plateau, l’imagination de Giono - ou de ses personnages - la crée. Dans Regain, celle-ci pouvait prendre parfois des accents désespérés et dérisoires à travers le simple jet de pierres, «rien que pour les voir monter». (Regain, I, 357). Dans Que ma joie demeure, elle a les sens pour impulsions, et pas seulement la vue, peut-être parce que «quand on voit on n’imagine plus» (II, 434), comme le déclare Bobi. Giono use souvent des sons qui révèlent un volume possible par un jeu de résonances.
Le plateau frappé de partout par la foudre sonna comme une cloche. (II, 773)
La voûte du ciel sonnera sous son galop comme la terre sonne maintenant (II, 549)
Le martèlement de la galopade monta jusqu’aux nuages puis retomba sur la terre. Ce bruit multiplié fit apparaître la solitude. Il n’y avait plus dans le vaste monde que Bobi poursuivant la jument. (II, 659)
C’était tout simplement le ciel qui descendait jusqu’à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. (II, 415)
Et l’air de flûte était toujours là avec de plus en plus de la précision, et parfois ça montait aigu jusqu’au tonnerre du ciel, et d’autres fois ça redescendait sur la terre et ça s’étendait en musique comme un large pays avec des ondulations de collines et des serpentements de ruisseau. (II, 420)
Mais de ce volume, le regard tend à ne conserver que la verticalité et non la profondeur, comme écrasée contre une vitre si bien qu’étendues et horizons se trouvent dressés dans un plan vertical. « L’espace le plus naturel suffit à fournir aussi bien quelque aventure du regard ; l’une de celles qui reviennent le plus souvent force l’horizon terrestre ou marin à se mettre debout tel qu’on le verrait effectivement si notre raison ne venait corriger l’étagement des choses vues. » écrit R.Ricatte[11] Ce faisant, Giono procède comme un peintre ignorant de la perspective.
Tous les chemins étaient ouverts et les horizons ne les bouchaient plus mais ils étaient relevés au-dessus des chemins comme des tentes. (II, 568)
Et, là, elle [la mer] apparaît si large, si terriblement large, si plate, si profondément enfoncée dans le ciel, qu’on se rend compte, en pensant au plateau Grémone, qu’elle est tout près de nous, car, sans cette obligation qu’elle a d’être collée sur le rond de la terre, elle monterait si haut, tout en restant plate, que nous la verrions apparaître au-dessus des montagnes d’Aiguines, avec son charruage de bateaux et ses gros poissons noirs qui dorment pendant que le soleil et l’eau écument dans leurs poils. (II, 568)
Même ce qui se dérobe au regard dans le lointain, Giono le juche et l’empile sur ce qu’il voit. Il emplit le grand ciel vide, miroir du plateau, et quand la mer s’y répand, elle charrie ce qu’il faut de bateaux et de « gros poissons noirs » où le regard puisse s’ancrer de peur qu’il ne se noie dans cette autre étendue, si vaste et si déserte. Toujours le vertige. Aussi, par l’imagination, s’efforce-t-il de ramasser l’espace en une sphère qui l’entoure, le dégage de l’exposition solitaire sur un monde plat et le libère de son face-à-face avec ce dernier. Il fait sienne une telle sphère en la jalonnant de choses grosses de son affectivité ou de ses hantises.
La rondeur close
C’est bien une sphère à partir d’une étendue plane que parvient à créer, par un tour de force, l’imagination. Elle façonne, par opposition au plateau, un espace alliant verticalité et rondeur sur laquelle Giono met un accent tout particulier. Dès le début du roman, celle-ci suspend la morosité de Bobi, comme un point d’orgue.
Pas malheureux, pas heureux, la vie. Des fois il [Bobi] se disait… Mais tout de suite, au même moment, il voyait le plateau, et le ciel couché sur tout et loin, là-bas loin à travers les arbres, la respiration bleue des vallées profondes, et loin autour il imaginait le monde rouant comme un paon, avec ses mers, ses rivières, ses fleuves et ses montagnes. (II, 418)
La diversité du monde qui s’accumule dans cette phrase, finit embrassée par ce qui présente la forme d’une roue. Ce qui est rond constitue l’aboutissement du regard prolongé par l’imagination. Bobi lui-même va incarner cette rondeur désirée à l’occasion d’acrobaties qu’il effectue devant ses hôtes Marthe et Jourdan. Il devient «l’homme-roue » (II, 506). Et cette rondeur s’étend au monde qui l’entoure, conformément au principe énoncé par Bachelard, selon lequel « l’être rond propage sa rondeur. »[12]
autour de la ferme, le monde grondait comme une grande roue qui tourne. (II, 435)
Je ne dis pas que la pierre est morte. Rien n’est mort. La mort n’existe pas. Mais, quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. (II, 465)
Il faisait encore nuit ronde et le temps était doux. (II, 480)
Qu’elle [la joie] soit la participante comme la mer qui danse, le fleuve qui danse, le sang qui danse, l’herbe qui danse, le monde tout entier qui tourne en rond. (II, 567)
Dans Manosque-des-Plateaux, Giono écrit que «le rond pays [est] sous le couvercle du ciel bleu » (p. 37). De même, dans Que ma joie demeure, l’espace rond se loge sous une voûte.
le haut du ciel est comme une voûte de cave (II, 483)
la voûte du ciel sonnera sous son galop comme la terre sonne maintenant (II, 549)
Celle-ci le contient, le circonscrit et, du fait de sa concavité, le tourne vers l’intérieur. Le «dedans» et la rondeur s'appellent l'un l'autre, confirmant l'analyse de Bachelard pour qui « les images de la rondeur pleine nous aident à nous rassembler sur nous-mêmes, à nous donner à nous-mêmes une première constitution, à affirmer notre être intimement, par le dedans. Car vécu du dedans, sans extériorité, l’être ne saurait être que rond »[13].
Cet espace ne s'ouvrant pas sur l'infini, l’horizon ne peut être une ligne de fuite. Mais il se présente tel une barre entre la terre et le ciel, comme dans Regain ou Manosque-des-Plateaux, qui obstrue le champ de vision et participe de la clôture de l'espace.
Entre la forêt et le ciel la neige des feuillages était comme une barre. (II, 440)
Loin derrière, les champs grisâtres et la ligne fermée de l’horizon. (II, 529)
L’horizon était noir comme la nuit et fermé de tous les côtés. (II, 665)
Même la nuit qui, sur un plateau désert, devrait apparaître comme une immensité noire sans limites se révèle au contraire « terriblement fermée de tous les côtés » (II, 583).
2. Saturer le vide
Le large, ou l’entre-deux vide, et le besoin de plénitude
Le volume créé, à la fois rond et clos, n’en demeure pas moins creux, sonnant « comme une cloche » (II, 773) si la foudre vient le frapper. Il est constitué d’un vide en ce «large» du plateau souvent évoqué qui, de par son nom même, est une étendue vague, indéterminée, qui n’a de définition que l’impression qu’elle suscite, que la qualité contenue dans l’adjectif substantivé. Il n’offre au regard rien où trouver un repère et un ancrage précis :
Mais le large du plateau était toujours vide. (II, 506)
Mais droit devant il n’y avait plus rien que le plateau désert avec deux ou trois fumées de brume. (II, 509)
Et l'horizon qui n'est pas une ligne de fuite prolongeant une étendue mais la barre sur laquelle le large vient buter, fait ressortir la nudité qui le précède, et l'expose.
De cet entre-deux, le large, qui a son unité, qui commence là où porte le regard et s'arrête sur la barre qui le clôt, l'homme et horizon sont les deux rives. Leur existence lui est subordonnée et elles tentent de l'enfermer et de le contenir de crainte qu’il ne les submerge. C’est ce trou béant, l’impression de vide qu’il suscite, qui poussent l’imagination à combler le « dedans » du volume créé, tout comme le sentiment d’écrasement, évoqué précédemment, l’a incitée à en dresser les contours. Semble valoir pour ce roman ce que Michel Collot note à propos du poème dont l'objet est « un lieu, qui plus est un lieu vide (…) un rien tranchant d’où tout advient, qui est la charnière de toutes choses. (…) cette illusion spacieuse, cette vacance, cette unification jamais objectivable, ce milieu dont le réel vient hanter toutes les lisières. »[14]
Alors, du large comme du désert, qui ont en commun nudité et solitude, « tout peut surgir » :
Regarder le désert, c’est regarder le rien. Il n’y a donc plus d’objet du regard, il ne reste que le regard dans sa solitude. Et s’étant dépouillée, la conscience va fabriquer son propre objet : le désert est le territoire de l’imaginaire, la matrice des rêves. Il suscite ce vertige que l’on peut éprouver face à ce qui est si dénué de tout que tout peut en surgir : il est le pays de l’attente[15].
Et les habitants, Jourdan notamment, sont dans l’attente. Ce dernier, saisi du vertige propre au plateau, qu’il nomme la lèpre, est tenté de s’en remettre au néant, de « demander au vide » (II, 428) de l’aveu même de Marthe, et il ne semble ni pouvoir ni penser se guérir par les forces de l’imagination auxquelles Bobi seul paraît avoir accès. Ces forces n’auront pas pour dessein de rêver une fuite, un au-delà du plateau, mais de saturer la rondeur close qu’elles ont déjà créée. En effet, le vide au cœur d’un volume clos et privé de tout support vertical, appelle l’imagination à l’emplir, de même que dans l’architecture baroque l’effacement de la colonne l’invite à s’emparer de l’espace ainsi libéré.[16] Au vide répond donc un besoin de plénitude que l’imagination assouvit. « L’invention spatiale (…) en évacuant la géographie réelle, semble répondre à un appel, à un manque qui exige d’être comblé : il y a dans l’espace des plages vides, des absences. Le monde imaginaire, débarrassé de ces scories qui, dans la fiction ordinaire, représentent justement le réel avec son insignifiance, toute la transcendance qui pèse sur l’œuvre, est un concentré d’espace, une reconstruction où tout est saturé de sens. » [17]
Ainsi le ciel, la forêt et les habitants eux-mêmes se gorgent de vie.
On ne pouvait plus voir tous les oiseaux.
On savait seulement que maintenant tous les buissons étaient prévenus. Il devait même y avoir comme une étrange nouvelle dans le ciel : une chose sirupeuse et dansante comme les traces de la chaleur de l’été. (…).
Elle [Marthe] pensait au grand ciel vide tout à l’heure et maintenant à cette foule. (II, 466)
La forêt était couverte de feuilles. Elle tenait deux fois plus de large qu’avant. Avant, elle n’était qu’un grillage de bois noir contre le ciel. Maintenant elle était grasse et gonflée. (II, 697)
Elle [Marthe] avait été enceinte au début du mariage avec Jourdan, mais elle n’avait pas pu mener à terme. Elle se souvenait de comment elle s’était d’abord senti les seins durs et tiraillés, puis, peu à peu ce remplissement de tous les vides de son corps et cette plénitude qui s’organisait en elle. Elle était comme de nouveau pleine, mais cette fois elle avait deux joies mélangées : d’abord la joie béate du corps fécondé et puis une joie allègre et sauvage (II, 467)
Le voyage immobile
L’immobilité des paysans du plateau est des plus propices à la rêverie car, selon Bachelard, « dés que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs ; nous rêvons dans un monde immense. L’immensité est le mouvement de l’homme immobile. »[18] A ces hommes et femmes sédentaires, dont l’imagination ne peut s’alimenter à la source des voyages, Bobi le plus souvent se garde d’évoquer les lieux de ses errances passées. Il les invite à recréer le monde à partir de ce que ce dernier offre aux sens, et le vent supplée à l’immobilité des paysans en leur apportant les formes et les couleurs des nuages, des sons et des odeurs à même de mettre en branle leur imagination. « Le vent voyage pour nous. »[19] Il apporte même aux « voyageurs immobiles » du plateau, par allusion au titre d’une nouvelle de Giono, la couleur et les ombres de la mer lointaine.
Le vent bleu monta de la mer.
Il est chargé de nuages. (…). Il couche de grandes ombres sur les prés, sur les terres où le blé pousse, sur les bosquets d’arbres. Ces ombres, épaissies par le reflet des sèves nouvelles, sont les plus bleues de toutes les ombres. Le ciel est entièrement habité d’un bout à l’autre par d’immenses nuages à forme d’hommes monstrueux, ou de bêtes, ou de chevaux. (II, 568-569)
Le vent parcourt en tous sens le plateau et son volume, brasse son contenu, se gonfle de tout ce qu’il trouve en chemin et concourt au sentiment de plénitude.
Le vent parlait. C’était un vent laiteux comme tout le reste. Il était plein de formes, plein d’images, de lueurs, de lumières, de flammes qui n’éclairaient pas un centimètre de la terre mais qui illuminaient tout le dedans du corps. (II, 483)
Et Bobi le vagabond qui doit au hasard des chemins et des rencontres son séjour sur le plateau Grémone, songe alors à y demeurer pour toujours.
Cette terre toute plate, continuait-il à se dire, me faire croire que cette fois c’est pour longtemps. Pour toujours. Il se répéta : « Pour toujours. » (II, 551)
Un flot et une fleur
Les sons aussi, portés par les vents, deviennent autant d’images renvoyant à l’espace.
Au-delà de la forêt Grémone – et ça devait être loin en bas dans la pente - on entendait ronfler la mince roue d’acier d’une scie mécanique. Dans la plaine un train siffla. Un oiseau passa au-dessus de la Jourdane. Il venait des montagnes. Il descendait vers un large pays qu’il devait déjà voir de là-haut. Il allait à grands coups d’ailes. On les entendait malgré la hauteur où il volait. Il passa au-dessus du verger. Le battement de son vol claqua dans les échos des arbres en fleur. Des roulements rapides de charrettes éveillaient dans la plaine la sonorité des bosquets de peupliers, et dans les petits moments du plus grand silence on entendait venir du delà de plus de vingt collines le sourd grondement de la ville où tout le monde était sorti pour goûter le soir sous le feuillage nouveau des grands ormes.
Tout s’était clarifié. On entendait autour du plateau l’élargissement de la vie du monde. (II, 562)
Des bruits précis, détachés d’une rumeur confuse (le ronflement d’une roue de scie mécanique, le sifflement d’un train), et lointains (au-delà de la forêt Grémone, dans la plaine) donnent une première sensation de distance et d’espace, complétée par la vue d’un seul oiseau (il vient des montagnes, il descend vers un large pays). S’enchaîne alors toute une série de sons qui s’appuient sur deux éléments génériques communs : les arbres (verger, arbres en fleur, bosquets de peupliers, grands ormes) et l’au-delà du plateau déjà introduit (la plaine, du delà de plus de vingt collines, la ville). De ce fait, les sons constituent plus qu’une énumération de bruits disparates, ils peuvent se suivre dans un même flot cumulatif qui enfle pour aboutir à « l’élargissement de la vie du monde ». Ce que les sens perçoivent ne concerne d’abord qu’une roue, qu’un train, qu’un oiseau, avant de se placer sous le signe du nombre (des roulements rapides de charrettes, des bosquets de peupliers, vingt collines) puis d’un Tout (le sourd grondement de la ville, tout le monde, tout s’était clarifié). Cet autre exemple atteste de ce même mouvement de l’imagination :
Elle [Marthe] voyait des loriots. Elle pensait au vent d’ouest. Parce que les loriots viennent toujours mêlés aux bourrasques. Elle voyait des rousseroles. Elle pensait à la rivière Ouvèze couchée au fond de sa vallée fauve et dans les joncs dansent les nids de rousseroles.
Elle voyait des calandres avec les tâches de rouille. Elle pensait aux fins d’été, à la touffeur des éteules, aux gémissements de la terre, aux bruits des chars, à l’envie de boire, aux landes beurrées de soleil. (…)
Chaque fois que toute la bande s’épanouissait autour du tas de graines, une fleur de plumes s’épanouissait aussi dans Marthe mais elle avait des ailes de vent, de plaines et de montagnes, des yeux de soleil, le ventre bleu du soir dans la campagne et le bruissement de tous les insectes des prés. (II, 468)
Ici, c’est le regard seul qui distingue quelques oiseaux. Mais chacun d’eux, au-delà de sa description, entraîne Marthe vers des pensées et des sensations les plus diverses, mais dont les indications spatiales ne sont jamais absentes (vent d’ouest, la rivière Ouvèze et sa vallée, landes beurrées de soleil, la montagne, le plateau) de sorte que, là aussi, ces évocations successives d’oiseaux ne se réduisent à quelque énumération. Le groupe d’oiseaux réunis suscite d’ailleurs en Marthe l’image d’une « fleur de plumes » associée à l’espace où sont rassemblés le vent, les plaines, les montagnes, le soleil, la campagne et les prés. Le mouvement de l’imagination ne peut se satisfaire des détails qui l’amorcent. L’accumulation de songes et d’impressions ne se limite pas aux oiseaux qui les déclenchent et les rechargent ; elle investit tout un espace. Le plateau Grémone lui-même paraît ne plus suffire. Il est question à la fin du roman d’un grand pays qui l’excède («le long des veines et des artères du grand pays au milieu duquel se trouvait le plateau Grémone» (II, 727)). Les images semblent avoir « un destin de grandissement »[20] et même de démesure[21].
C’est à ce moment-là qu’il entendit le clairon. Il jouait au fond de la nuit. Il avait des sons enroués et mouillés. Ses notes étaient comme les mains molles de Dieu. Elles s’ouvraient et, dans l’humidité moite de leurs paumes, on voyait des graines vivantes crevées de partout, débordantes de forêts et de bêtes. Les forêts ruisselaient d’entre les doigts humides, elles coulaient sur la terre, elles jaillissaient de la terre avec leurs amas de feuillages, leurs longs corridors sonores, leurs charpentes huilées de feuilles et de soleil. (II, 567-568)
Destin comparable à la poussée qui sourd de la terre et de ses fruits, au mouvement d’ex-croissance qui s’empare de la nature encline à déborder tout ce qui l’enferme.
Les cosses s’ouvraient en crépitant, les graines coulaient sur la terre, le fléau des avoines jetait des graines, les bardanes jetaient des graines, les mousses expulsaient d’un seul coup de petites graines d’or que le moindre vent emportait. Les têtes de datura craquaient, s’ouvraient, délivraient de leur coque de satin blanc les trois noix couleur de la nuit. Les choux pleins d’humidité et travaillés par la chaleur sentaient fort. Les betteraves, les oignons, les navets, les grosses carottes sortaient de la terre poudreuse, poussés par le gonflement de leurs chairs. Dans tous les endroits ensoleillés de la montagne, les abricotiers sauvages pleuraient de la sève et du jus. (II, 739)
Comme si le vide à combler venait à manquer, l’imagination ne semble pouvoir se limiter à la rondeur close. « La pulsion centrifuge qui anime Giono (…) est peut-être la conséquence contradictoire d’un choix de l’espace clos »[22] propose R. Ricatte. Saturer d’images un espace fermé porte en soi le risque d’un excès de plénitude.
Toutefois, ce flot n’emporte pas l’espace créé que l’habitant du plateau avait fait sien. Il est contenu, ou plutôt récupéré, détourné en une sorte d’apothéose qui le sublime.
Tout d’abord, l’espace qui s’emplit d’images est celui d’un monde rond, métamorphosé et d’une unité accomplie. Celle-ci, mêlant la terre et le ciel, s'illumine de métaphores dés les premières phrases du roman, avant toute parole, telle une révélation.
C’était une nuit extraordinaire.
Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l’herbe. Elles étaient en touffes avec des racines d’or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.(II, 415)
Mais Bobi trouve pour l’unité cette figure imaginaire qui lance le roman et longtemps l’accompagne : « Orion fleur de carotte ». Elle symbolise la toute puissance de l’imagination. La constellation dans une corolle née d’une maigre racine suggère la diffusion et le rayonnement dans l’espace d’une matière originelle dérisoire, fondant de nouveau le ciel et la terre dans un Tout. Il suffit à Bobi «de prononcer cette formule incantatoire (…) pour que Jourdan, et, à sa suite, tous les habitants du plateau, saisissent par leurs sens l’unité réalisée : “ Alors tu as vu cette fleur de carotte et le ciel a été fleuri. ” »[23] La fleur épanouie, qu’elle soit celle d’une carotte, d’une plume ou de la joie comme dans Colline (I, 170), est l’image irréelle d’une harmonie offerte, d’une unité ronde qui s’ouvre et se libère dans le volume clos de l’espace. Elle est alors félicité, joie que Bobi voit certes « comme un pré gras » mais qui semble une fleur ou un arbre géant « avec des millions de racines dans la terre et des millions de feuilles dans l’air » (II, 567). Elle est l’envers du froid, du désert, de la nudité du plateau et du mal qui ronge ses paysans. Avec l’aide de l’imagination, le vertige du plateau, initialement source d’angoisse, procure l’extase qui resplendit jusque dans la mort, dans celle d’Aurore comme de Bobi, à travers des images de foudroiement ou d’éclatement toujours parées d’un halo, qui font d’elle une apothéose.
Avec ses éclaboussures de cervelle et de sang rayonnantes autour d’elle [Aurore], elle éclairait l’herbe et le monde comme un terrible soleil. (II, 752)
La foudre lui [à Bobi] planta un arbre d’or dans les épaules. (II, 777)
« Si le possible inscrit un vide dans le paysage, c’est qu’il rouvre au sujet l’abîme de sa liberté ; expérience “ vertigineuse ”, qui peut être vécue dans l’angoisse ou dans l’extase »[24].
3. Le panorama et le retour du temps, ou l’impossibilité du voyage immobile
Après lui avoir donné volume et rondeur pour y loger un monde immense et néanmoins intime, l’imagination finit par faire du plateau désert un panorama riche de ses créations. En effet, quoiqu’elle bâtisse un espace rond et clos, demeure la tentation de la vue panoramique embrassant l’immensité, plane ou étagée car, dans la félicité, dans les figures d’épanouissement ou d’apothéose – celles de l’arc-en-ciel, des plumets d’herbe, de la tête jaune du soleil, de ce dernier rouant ses effets ou bien encore l’évocation de la gloire dans l'exemple ci-dessous – qui l’accomplissent, le mouvement de l’imagination et des êtres s’immobilise. La plénitude de l’espace rêvé alors s’offre, s’étale. « On rêve avant de contempler »[25], affirme Bachelard.
Ils [le cerf et Zulma] marchaient tous les deux dans une sorte de gloire. (…).
Derrière eux, le verger, ses fleurs et les serpents noirs des branches, l’ombre du verger, une ombre flottante et douce, non pas noire mais verte comme la lumière au fond d’un ruisseau. Les arbres ne bouchaient pas le ciel. Ils étaient sur un fond de collines et de montagnes. Les collines, avec leurs landes à genièvre, les petits champs labourés, les bosquets et les forêts d’yeuses ressemblaient à des tapis de laine bourrue et mordorée (…). On voyait un petit village là-haut dans les plus hautes collines, à un endroit perdu. (…). Du côté de l’est, les arbres, les guérêts, les rochers mêmes verdoyaient à travers le ruisseau de lumière qui, jaillissant du soleil penché, coulait directement à même la terre. (II, 530-531)
Il y a bien la nuit qui, du panorama et de l’imagination figée, préserve le paysan du plateau. Prenant une dimension plus spatiale que temporelle, elle le lui dissimule car elle l’ensevelit, elle le noie dans sa pénombre, car, « sans borne, ni mesure, ni commencement, ni fin », elle « abolit le monde » (II, 756) : il n’y a « pas de barrières entre la nuit du ciel et la nuit de la terre » (II, 748) si bien que le « chemin s’en va devant vous, et vous pouvez l’imaginer tout plat parce que devant vous c’est la nuit où tout peut s’inscrire » (II, 730). La nuit conserve au voyageur toute son espérance. Mais elle ne peut suffire. Sitôt qu’elle se retire, le panorama lui apparaît de façon bien réelle, au-delà de toute échelle humaine, comme un facteur d’épuisement. A mesure que le jour se lève au sommet d’une colline, qu’il creuse les vallons, qu’il en révèle d’autres insoupçonnés et profonds, qu’il dresse toujours plus d’obstacles, rochers et ravins, comme pour épuiser le courage de Bobi, qui pourtant jamais ne lui manque, le désespoir le gagne et il conclut par ces mots : « "Que je fasse seulement un pas devant moi. C’est tout ce que la force me permet". Et toujours la lumière augmente !… » (II, 731)
A la fin du roman, Bobi succombe à la tentation du panorama qui, étalé comme un paquet de cartes à jouer, associant des visages aux éléments naturels, lui rappelle son passé et de nouveau lui donne la sensation du temps au point de se voir « en train d’être construit par le temps » et « d’entendre le bruit qu’avait fait le temps en construisant cet homme qui s’appelait Bobi. » (II, 756)
il [Bobi] entendit que le monde revenait autour d’eux : le cèdre, les arbres, la forêt, les champs, les montagnes, le torrent, les chemins, les hommes qui marchent à travers les terres, les grandes fermes, les cinq familles, les maisons, les lampes, les feux, les visages, Marthe, Jourdan, Honoré, Jacquou, Barbe, Randoulet, Zulma, Honorine, Mme Hélène.
La joie ?
Il n’y a pas de joie. (II, 704)
Il [Bobi] était un faisceau d’images. Il voyait des pays, plats comme des cartes à jouer, avec des arbres, des fermes, des champs et le serpentement des routes aplatis sur le carton. Sur toutes ces cartes était la figure d’un homme ou d’une femme. Il y avait sa mère ; le joueur de tambour qui l’avait suivi une fois dans sa tournée dans les pays ; l’homme avec la barbe rouge qui habitait la ferme forestière au col de Clans et chez qui il avait couché l’hiver de 1903 où il faisait si froid ; encore sa mère ; une femme appelée Fannette ; encore sa mère ; Aurore sans visage avec des cheveux durcis de sang ; une femme appelée Sonia qui faisait du trapèze volant sur les places des villages, le soir, avec deux trapèzes et une lampe à carbure ; encore sa mère, toujours blanche comme du lait ; l’homme appelé Fabre qui avait le théâtre ambulant de la vallée du Lauzon et qui jouait sur des tréteaux des pièces astronomiques avec sa femme appelée Voie Lactée et ses enfants appelés : Orion, Uranie, Sirius et Centaure. (II, 762)
Et Bobi de se parler à lui-même : «Tu veux me faire jouer aux cartes avec tes souvenirs » (II, 776)
Si un monde statique et plat, le panorama, le guette et le fige dans un passé scellé notamment dans les morts d’Aurore et de sa mère si bien qu’il n’a « plus l’impression d’être dans le monde » (II, 762), il lui faut partir. Car les images nouvelles sont celles de son passé. Saturé, d’une excessive plénitude, l’espace n’est plus à remodeler et à emplir. Le vertige du vide est devenu celui du trop-plein. Le voyage par l’imagination n’est plus possible, laquelle s’immobilise. Le temps, son écoulement, happés jusque là par une quête de la joie, par un avenir qui nie la durée et s’accomplit dans l’extase, de nouveau s’impose à l’esprit de l’habitant du plateau. Mais ce dernier n’a plus l’espace vide. Il éprouve alors le manque du manque, c’est-à-dire l’angoisse, selon Jacques Lacan. Et les images se figent et s’étalent en un panorama souvent décevant. « J’ai constaté le désappointement que fait souvent éprouver une vue purement panoramique. (…). On ressemble à l’homme au comble de ses vœux, et qui, n’ayant rien à désirer, n’est pas complètement satisfait. »[26]
Le calme aplatissait tout. Il n’était plus possible d’imaginer des vallées, des forêts, des profondeurs et des couloirs sonores où le vent marche. (…). Il n’y avait plus que cette terre plate. (II, 767)
Ainsi disparaît la rondeur du monde.
Celui qui faisait des acrobaties et se mettait en boule sur le tapis de jeu, offrant une vision autre du plateau, ne parvient plus à se défaire du panorama. Sa vie, sa mémoire, le temps, jadis enroulés comme son corps, à présent se déploient et s’étalent dans ses pensées.
Bachelard n’écrivait-il pas que « dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça »[27], ou encore que « c’est par l’espace, c’est dans l’espace que nous trouvons les beaux fossiles de durée concrétisés par de longs séjours. » [28] Une fois le mouvement de l’imagination interrompu, dans la contemplation panoramique la durée réapparaît.
Le temps ne s’est pas dissout dans l’espace.
Conclusion
De par sa vacuité uniforme et plane, le plateau, à l’instar de la mer ou du désert, appelle et défie l’imagination qui, dans Que ma joie demeure, lui prête verticalité et plénitude dans une rondeur close. Celle-ci, parce qu’elle figure un Tout unitaire, ne peut contenir ni définir une altérité, un ailleurs - la présence de la ville dans le roman est trop allusive et péjorative pour jouer ce rôle. Il n’y a ni lieu dont on soit éloigné qui vienne à manquer, donc nul exil, ni lieu possible à la croisée des routes, qu’on aurait pu connaître, néanmoins délaissé et désormais perdu, que Bonnefoy nomme l’arrière-pays. Et le poète de regretter de ne pouvoir saisir l’unité pressentie du monde et dépasser les lieux de hasard qu’il traverse.
l’idée de l’autre pays peut s’emparer de moi (…), et me priver de tout bonheur à la terre. Car plus je suis convaincu qu’elle est une phrase ou plutôt une musique – à la fois signe et substance – et plus cruellement je ressens qu’une clef manque, parmi celles qui permettraient de l’entendre. Nous sommes désunis dans cette unité, et ce que pressent l’intuition, l’action ne peut s’y porter ou s’y résoudre.[29]
Pourquoi ne pouvons-nous dominer ce qui est, comme du rebord d’une terrasse ? Exister, mais autrement qu’à la surface des choses, au tournant des routes, dans le hasard : comme un nageur qui plongerait dans le devenir puis remonterait couvert d’algues, et plus large de front, d’épaules, - riant, aveugle, divin ?[30]
L’objet de ce regret est le défi de Bobi : embrasser le monde du plateau, ce qui est au-delà du regard, par les sons et les odeurs, dans un mouvement de l’imagination qui confine à l’extase. Alors, oui, le nageur des herbes et du ciel est « riant, aveugle, divin ». Mais, en ce cas d’unité accomplie, l’ailleurs, donc l’arrière-pays n’existe pas. Le plateau qui s’étale devant Bobi, devant Giono, qui précède et inspire l’imagination transformatrice, cette « matière incessante de manipulations inventives »[31], mériterait davantage le nom d’avant-pays.
Reste que l’objet de ce regret est aussi de « ne pouvoir dominer ce qui est, comme au rebord d’une terrasse ».[32] Evoquée à propos de l’œuvre de Giono dans son ensemble, cette « tentation du panoramique qu’exerce la superposition fantastique et exaltante des espaces de la fiction et du réel », vaut notamment pour Bobi dans son entreprise de reconstruction du monde. Y céder ruinerait le pouvoir de son imagination et laisserait place à l’obsédante réalité trop encombrée de la mémoire. Ce ne serait plus une plongée dans le devenir, dans la métamorphose du monde, mais dans le temps. Quand ses forces de résistance viennent à défaillir, du fait notamment de la rencontre de la mort qui en rappelle une autre, celle de sa mère, quand son imagination a comblé le vide du plateau Grémone qui ne peut la contenir davantage dans son expansion et sa boursouflure, le chemin efface le plateau et Bobi redevient le vagabond des toutes premières pages.
[1] Pour les romans de Giono, les numéros de page renvoient à l’édition de la Pléiade (Colline et Regain t.I et Que ma joie demeure, t. II.) ; pour Manosque-des-Plateaux, à l’édition Gallimard Folio, 1986 (1ère éd.1930).
[2] Robert Ricatte, Préface des Œuvres romanesques complètes, Pléiade, p. XXII
[3] Luce Ricatte, Notice pour Que ma joie demeure, Pléiade, t. II, p. 1336
[4] Luce Ricatte, op. cit., p. 1334 (entretien de Jean Giono)
[5] Robert Ricatte, op. cit., p. XVII
[6] Gaston Bachelard, L’Air et les songes, José Corti Le Livre de Poche, 1943, p. 266
[7] Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, José Corti, 1947, p. 347
[8] Pierre Jourde, Géographies imaginaires de quelques inventeurs de mondes au XXe siècle Gracq Borges Michaux Tolkien, José Corti, 1991, p.47
[9] Toutefois, le sentiment d’écrasement sur un plateau ne saurait être l’impression obligée et le besoin de verticalité son corollaire inévitable, mais plutôt la façon qu’a Giono d’appréhender un tel lieu. Quand le plateau apparaît non sous la chape mais dans la continuité du ciel, avec une sensation d’élévation invitant à la spiritualité et participant d’un axe vertical, le vertige, lui, peut être horizontal si l’on en croit Julien Gracq (Carnets du grand chemin, José Corti, 1992 ) :
Une attraction sans violence, mais difficilement résistible, me ramène d’année en année, encore et encore, vers les hautes surfaces nues –basaltes ou calcaires- du centre et du sud du Massif : l’Aubrac, le Cézallier, les planèzes, les Causses. (…). Tonsures sacramentelles, austères, dans notre chevelu arborescent si continu, images d’un dépouillement presque spiritualisé du paysage, qui mêlent indissolublement, à l’usage du promeneur, sentiment d’altitude et sentiment d’élévation. (p. 98)
Rarement je pense au Cézallier, à l’Aubrac, sans que s’ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir : sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l’autre à tomber, m’incite à y courir, à m’y rouler, à perte de vue, à perdre haleine. (p. 64)
[10] Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, p. 357
[11] Robert Ricatte, op. cit., p. XI
[12] Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, PUF Quadrige (6ème édition), 1994, p. 213
[13] Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, p. 210
[14] Michel Collot, La Poésie moderne et la structure d’horizon, PUF, 1989, p.181
[15] Pierre Jourde, op. cit., p.54
[16] Après avoir relevé chez Pierre Charpentrat, spécialiste de l’architecture baroque, qu’ « il suffit à l’espace de Brunelleschi d’être enclos pour être défini, pour être consacré », Yves Bonnefoy ajoute concernant la colonne elle-même : « Expression de la rigueur antique, pièce essentielle d’une irrécusable géométrie, mesure de toute chose, la colonne devient, dans le système baroque, facteur de trouble. (…). Ce n’est plus sa rectitude qui compte, mais le vide qu’elle crée dans la masse architecturale, l’hiatus qui la sépare de sa voisine et qu’elle livre à notre imagination. »
Yves Bonnefoy, « L’architecture du baroque et la pensée du destin », L’improbable et autres essais, Gallimard Folio essais, 1992, p. 214-215
[17] Pierre Jourde, op. cit., p.290
[18] Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, p.169
[19] Marcel Neveux, Giono ou le bonheur d’écrire, Editions du Rocher, 1990, p. 203
[20] Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, p.190
[21] Opposant Colline à ses œuvres ultérieures, Giono confie : « Poursuivi par ce démon ou ce péché de la démesure, je n'ai pu retrouver l'économie de richesse qu'il y a dans Colline » (Jean Giono, Entretiens avec Jean et Taos Amrouche, Gallimard, 1990, p. 146). Robert Ricatte ajoute que Giono eut « cette révélation centrale : néant et démesure sont indissolublement liés. » (Robert Ricatte, op.cit., p. XXX)
[22] Robert Ricatte, op. cit., p. XVI
[23] Luce Ricatte, op. cit., p. 1346
[24] Michel Collot, op. cit., p.68
[25] Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, José Corti Le Livre de Poche, 1942, p.11
[26] Whymper cité par Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, p..374
[27] Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, p. 27
[28] Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, p. 28
[29] Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays, Gallimard Poésie, 1992, p. 11
[30] Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays, p. 12
[31] Cette expression, employée par Robert Ricatte, s’applique plus généralement à l’espace dans l’œuvre de Giono.
Robert Ricatte, op. cit. p. XXII
[32] Robert Ricatte, op. cit. p.XXIII